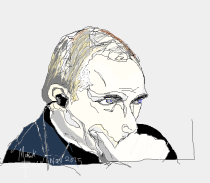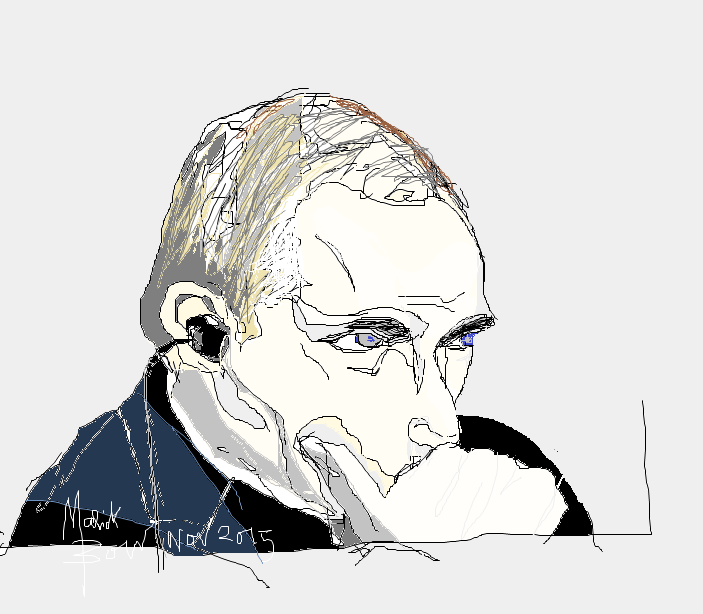
Traduit par Peggy Sastre
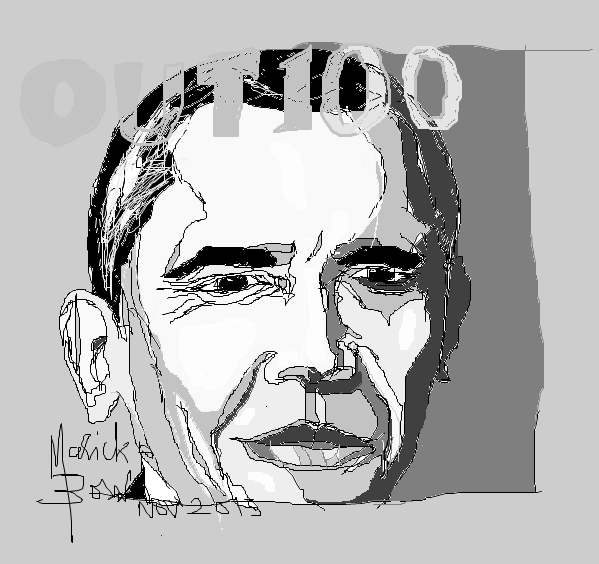
04.03.2016
Barack Obama et Vladimir Poutinlors du sommet du G20, à Antalya, en Turquie, le 16 novembre 2015 | KAYHAN OZER/POOL/AFP
Selon l’ancien commandant suprême américain des forces alliées de l’Otan, ce n’est pas une Russie forte que les États-Unis devaient craindre mais une Russie faible et une Union européenne faible ou divisée
Comme chaque année, les grosses légumes du monde se sont retrouvées au Forum de Munich sur les politiques de défense. Le raout existe depuis des décennies mais, cette année, après un week-end passablement doux pour la saison, son discours le plus dramatique allait avoir le froid comme sujet: celui de la Guerre froide, selon les mots de Dmitri Medvedev, le Premier ministre russe. On se souvient surtout de l’ancien président Medvedev, celui qui, voici quelques années, dirigeait la Fédération de Russie avec un visage bien plus affable que celui de son leader actuel, Vladimir Poutine.
Medvedev était manifestement en mission commandée: exposer à l’Occident (l’Europe, les États-Unis, l’Otan) le point de vue de Moscou. Et dans une longue et parfois confuse harangue, son argument-clé eut de quoi faire dresser les cheveux sur la tête: nous vivons une nouvelle Guerre froide et 2016 lui rappelle 1962 (qu’importe qu’il n’eût pas encore vu le jour à cette date). Pour ceux qui auraient besoin d’un petit rappel, c’est en 1962 que survint la Crise des missiles de Cuba, une année où le monde fut à deux doigts de la guerre nucléaire. Pas vraiment le genre de souvenir rassurant à évoquer lors d’une conférence sur la sécurité internationale.
À Munich, mes amis et collègues russes ont été nombreux à vouloir prestement préciser ses propos: «En fait, ce qu’il voulait dire, c’est qu’il faut faire attention à ne pas retomber dans une Guerre froide.» Le discours était donc à prendre comme une cordiale mise en garde, à l’heure où nous multiplions les sanctions à l’égard de la Russie, conséquences deson invasion illégale de l’Ukraine et de son annexion pure et simple de la Crimée. Qu’on me pardonne mais, dans l’oreille de la grande majorité des non-Russes, le ton n’avait rien de conciliant et la menace était en réalité assez mal voilée. Beaucoup allaient même y percevoir un véritable cri du cœur: si les choses ne se déroulent pas comme les Russes l’entendent (levez les sanctions, laissez Assad régner sur la Syrie, faites preuve du profond respect que vous nous devez) alors cette nouvelle Guerre froide deviendra la nouvelle norme.
À LIRE AUSSI
Dans les relations internationales, il est temps de désanctifier les sanctions
Réalisme
Commençons par une petite vérification de la réalité: nous ne vivons pas une nouvelle Guerre froide. Contrairement à Medvedev, je suis assez vieux pour me souvenir de la vraie Guerre froide: il y avait des millions de soldats stationnés dans la Trouée de Fulda, deux énormes flottes de combat parcourant les mers du monde dans un À la poursuite d’Octobre rouge d’ampleur planétaire et deux gigantesques arsenaux nucléaires pointant l’un vers l’autre, à un cheveu de réduire le monde en poussière. Le dialogue et la coopération entre l’Union soviétique et l’Otan étaient quasiment inexistants. Les guerres par procuration pullulaient. Heureusement, nous n’en sommes pas de nouveau là.
Franchement, la Russie ne mérite pas nos insomnies. Par contre, les États-Unis devraient être préoccupés par l’Europe
Mais soyons réalistes dans l’évaluation du message envoyé par Moscou à Munich: voici un régime sous le coup de pressions économiques internes des plus significatives, conséquences des sanctions et de la baisse des cours du pétrole. Qu’on y ajoute une démographie sur le déclin, un problème d’alcoolisme et de toxicomanie endémique, une baisse de l’espérance de vie, une économie largement dépendante des matières premières, et les difficultés auxquelles est confrontée la Russie n’en deviennent que plus flagrantes –même si sa démographie a connu quelques mieux dernièrement. Nous ne devrions pas avoir peur de la force de la Russie mais de sa faiblesse –parce qu’elle est toujours dotée d’une armée puissante, de la volonté de s’en servir et d’un arsenal nucléaire dépassant les 7.000 ogives (ce que les Russes ne manquent pas de rappeler à notre bon souvenir).
Franchement, la Russie ne mérite pas nos insomnies. Par contre, les États-Unis devraient être préoccupés par l’Europe et les forces centrifuges qui semblent inexorablement désunir les alliés dont nous sommes les plus proches au monde. Une Union européenne faible ou divisée est un revers géopolitique majeur pour les États-Unis.
Cohésion
La question à se poser, compte tenu de la faiblesse de la Russie et d’un prétendu retour de la Guerre froide, à l’heure où la nervosité s’empare d’une Europe de plus en plus fracturée est la suivante: quelle est la meilleure chose à faire pour les États-Unis?
Primo, nous devrions renforcer l’Otan. L’Alliance est au fondement de la sécurité en Europe, malgré ses erreurs et ses errements. Renforcer l’Otan signifie admettre un vingt-neuvième membre en son sein, le petit mais enthousiaste Monténégro, lors du Sommet de Varsovie à l’été 2016. Il convient aussi d’insister auprès de nos partenaires européens pour qu’ils satisfassent à la limite des 2% de leur PIB investis dans leur défense –un seuil fixé par l’Otan que seuls cinq pays membres respectent à l’heure actuelle (les États-Unis le dépassent, avec 3% de leur PIB consacrés à la défense). De même, l’Otan devrait renforcer la présence de ses forces rotationnelles à l’est (sans les stationner de manière permanente); réagir vigoureusement aux intrusions de la Russie dans les espaces maritimes et aériens des pays affilés à l’Otan; mener des exercices défensifs réalistes, notamment dans la Baltique; et stationner des forces aériennes prépositionnées capables de se déployer en Pologne.
Deuzio, il faut que Washington envoie régulièrement ses représentants en Europe, afin de renforcer le sentiment de cohésion de l’Alliance et rassurer un continent très nerveux face aux agissements de la Russie en Géorgie, Moldavie et Ukraine. Des cadres de l’armée américaine devraient être engagés à des postes de commandement au sein des armées européennes.
Et c’est à Washington d’insister fréquemment sur son espoir de voir la Grande-Bretagne rester dans l’Union européenne –nous voulons une Europe unie, capable de siéger à la table de la communauté internationale aux côtés des États-Unis. Après tout, l’Europe représente 500.000 millions de citoyens et un PIB dépassant celui des États-Unis; nous avons besoin d’un partenaire uni et cohérent. Si le premier objectif de ces mesures est de rassurer l’Europe, elles auront aussi un effet dissuasif sur les velléités aventureuses de la Russie.
Dialogue
Ces mesures ont pour objectif de rassurer l’Europe, elles auront aussi un effet dissuasif sur les velléités aventureuses de la Russie
Tertio, nous devrions nous engager dans le cyberespace aux côtés de nos collègues européens. Ce qui ne se limite pas à la cyberdéfense (via le centre d’excellence de Tallinn, en Estonie) mais demande aussi de réfléchir à des initiatives public-privé garantissant à la fois une protection adéquate de la vie privée et le déploiement d’un internet mondial. Si les États-Unis et l’Europe sont alignés sur ces questions fondamentales, nous avons de bien meilleures chances de pouvoir nous protéger tout en veillant à ce qu’internet reste largement accessible et bénéficie d’un juste niveau de confidentialité.
Enfin, il importe de garder ouverts les canaux de communication avec le Kremlin. Le dialogue, notamment entre armées, permet de diminuer les risques de collision accidentelle ou autre incident aérien. Le secrétaire d’État américain John Kerry et le ministre des Affaires étrangères russe Sergeï Lavrov doivent continuer leurs échanges étroits et personnels. Nul besoin de retomber dans une Guerre froide qui ne profite à personne.
À Munich, le ministre des Affaires Étrangères polonais s’est vu poser cette question par un Russe visiblement dépité: «Bon, quelle est notre part de l’Europe?» Ce qui sous-entend que l’ancienne zone d’influence russe était globalement devenue celle de l’Otan et de l’Union européenne. Sans hésiter longtemps, le dirigeant polonais lui a simplement répondu: «Votre part de l’Europe, c’est la Russie.» Personne, que ce soit aux États-Unis ou au sein de l’Otan, n’a envie de mettre un pied en Russie. Nos collègues de Moscou devraient donc laisser les nations européennes libres de leurs décisions quant à leurs propres objectifs. C’est encore le meilleur moyen d’éviter un retour de la Guerre froide.